Je me fais le relai de Didier Pruneau avec cet article ci-dessous. Bonne lecture.
En 2015, j’ai écrit un article qui impliquait l’épandage de lisier et la charge azotée en résultant, comme cause majeure du développement du champignon Saprolegnia parasitica chez la truite et l’ombre dans les rivières Loue, Doubs, Cusancin, et Dessoubre. Dix ans après, je souhaitais faire un point sur les données scientifiques nouvelles permettant de comprendre un peu mieux les causes d’infection par Saprolegnia parasitica, maladie fongique qui loin d’avoir diminuée continue de faire des ravages dans les rivières karstiques de Franche-Comté.
Il est aujourd’hui établi que le développement de l’oomycète Saprolegnia parasitica est systématiquement associé à la mortalité des truites et ombres des rivières de Franche-Comté (par ex. Loue, Doubs, Cusancin, et Dessoubre). Ce champignon naturellement présent dans les cours d’eau attaque généralement des poissons affaiblis physiquement et immunologiquement. Ainsi, la fraie conduit à des abrasions de la peau favorisant l’infection fongique et entraine une baisse de l’immunité. Mais hélas en Franche-Comté, la mortalité se poursuit bien au-delà de cette période et des poissons malades peuvent être observés toute l’année avec toutefois, un pic entre janvier et avril. Plusieurs études ont été conduites visant à déterminer les causes de la dégradation écologique de la Loue et du Doubs. Les conclusions d’un travail important conduit par PM Badot et F Degiorgi (Université de Besançon) sur la Loue de 2012 à 2018 sont les suivantes :
« Les dysfonctionnements écologiques mis en évidence dans la Loue sont induits principalement par les causes suivantes:
1. Les excès d'azote dans les milieux aquatiques et l'accroissement des teneurs en bicarbonates sont la conséquence de l'intensification des pratiques agricoles.
2. Les contaminations multiples par des produits phytosanitaires, des biocides et les substances actives issues des médicaments vétérinaires sont elles aussi en partie liées à l'intensification de l'agriculture.
3. Une part sans doute non négligeable de ces contaminations trouve aussi son origine au sein de la filière bois par le biais des traitements des grumes en forêt et en scierie, mais aussi dans les utilisations domestiques (insecticides en poudre, en aérosol, biocides en tout genre, produits de traitement des bois d’œuvre...).
4. La collecte et le traitement des eaux usées ne sont pas impliqués au premier chef dans les contaminations azotées mais présentent des marges de progression pour réduire leurs contributions aux apports de substances toxiques et de bouffées de phosphore dans les cours d'eau.
5. Une contamination par des concentrations parfois très élevées d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lourds non solubles existe à l’échelle du bassin versant dans les différents types de prélèvements analysés et notamment dans les particules fines (sédiments et matières en suspension).
6. La nature karstique du substratum et le positionnement en tête de bassin accroît la vulnérabilité des cours d'eau, vis à vis des contaminants chimiques qui peuvent être transférés des sols vers les eaux et transportés très rapidement au sein des masses d'eau.
7. Les modifications physiques des cours d'eau et les altérations de la végétation de bordure – réduite et artificialisée – dégradent les habitats des poissons et des communautés vivant au fond et constituent des facteurs aggravants. »
Selon PM Badot en 2020: « Les quantités d’effluents d’élevage épandus sur les prairies ont augmenté car la productivité du troupeau s’est améliorée : de 4000 kg/an de lait par vache en 1960 à 7000 kg/an au début des années 2000. Cela s’accompagne aussi d’un recours plus important aux engrais. Des épandages qui ne tiennent pas encore assez compte de la nature du sol. Quand il est superficiel, c’est-à-dire peu épais, ou quand la végétation, c’est à dire l’herbe n’est pas en croissance active pendant l’automne et l’hiver, ces intrants ne sont pas assez assimilés et se retrouvent dans la rivière. D’où le constat d’un excès d’azote dans les milieux aquatiques, qui favorisent les croissances végétales dans la rivière. ». « La pratique revient à fertiliser, engraisser la rivière et pas la prairie ».
Le projet NUTRI-karst d’une durée de cinq ans et terminé en 2024 avait pour objectif de comprendre l’impact des activités humaines sur les transferts d’eau et de nutriments dans les bassins karstiques du massif du Jura. S’il est difficile de résumer l’ensemble des données collectées du fait de leur nombre et complexité, une des principales conclusions est rapportée ci-après :
« Dans un contexte où une intensification des sécheresses estivales est attendue, les perspectives portent alors vers une augmentation de l’intensité du lessivage de l’azote si rien n’est fait pour en diminuer les apports. Aussi, il apparait donc plus que nécessaire de redoubler d’efforts sur la réduction des apports de nutriments, du fait de l’influence des sécheresses sur la mobilisation et le transfert d’azote vers les eaux ; notamment dans un contexte de réchauffement climatique qui risque d’accentuer le risque d’eutrophisation des cours d’eau. »
J’avais précédemment évoqué il y a dix ans le rôle potentiel de la charge azotée (en particulier la forme ammoniacale del’azote) dans le développement de Saprolegnia parasitica, sans exclure d’autres sources de pollution renforçant l’affaiblissement des poissons. Que sait-on de nouveau ?
Rien, si l’on considère que la grand majorité des études conduites sur la saprolégniose visent à étudier des inhibiteurs de cette maladie dans le but de protéger l’aquaculture. Signalons toutefois une étude récente (Pavic et al., 2022) rapportant une méthode rapide, sensible et spécifique permettant de mesurer la distribution et la prévalence de S. parasitica dans l’environnement, notamment dans l’eau des rivières. Cette méthode utilise la technique de « droplet digital PCR (ddPCR) », technique maitrisée dans la majorité des laboratoires. Les chercheurs ont ainsi montré que S. parasitica était largement et naturellement présent dans les rivières de Croatie. Par ailleurs, ils ont montré que le taux de S. parasitica dans l’eau augmentait avec la conductivité électrique. Or, l’augmentation de conductivité électrique est largement documentée dans les rivières de milieu karstique telles que la Loue, où elle est progressivement passée de 250 µs/cm dans les années 70 à 470 µs/cm en 2014 (Conseil Scientifique du comité de Bassin Rhône-Méditerranée, 2015). Ceci résulte de l’augmentation des taux de calcium et bicarbonates dans l’eau. Il a aussi été observé que S. parasitica était présente sur la peau des truites mais que les taux étaient largement augmentés sur la peau comportant des lésions, ceci étant cohérent avec la mortalité post-fraie. Enfin, les taux de nitrates ne semblent pas influer sur les concentrations de S. parasitica.
En conclusion, plusieurs études confirment, s’il en était besoin, que l’état écologique des rivières de Franche-Comté s’est fortement dégradé du fait des activités anthropiques. L’excès de charge azotée est essentiellement du aux activités agricoles en particulier l’élevage bovin. Ceci est largement documenté dans les études menées depuis 2010. Les seuls éléments nouveaux concernant S. parasitica par rapport à l’étude que j’avais produite en 2015 sont la possibilité de mesurer de façon fiable les taux de cet oomycète dans l’environnement, et la démonstration que la conductivité électrique est corrélée avec les taux de S. parasitica dans les rivières. A ma connaissance, rien de nouveau n’a été, hélas, publié pour ce qui concerne le ou les éléments présents dans l’eau susceptibles d’entrainer et/ou potentialiser l’infection par S. parasitica.
Enfin, j’ajoute que les méthodes d’épandage de lisier se modifient avec l’abandon de la buse-palette (projection aérienne en éventail) au profit de matériel de type pendillards ou enfouisseurs/injecteurs. L’épandage classique par buse-palette entraine jusqu’à 50% de perte de l’azote ammoniacal par évaporation. Le matériel de type pendillards et le matériel de type enfouisseurs réduisent respectivement de 30 à 55% et de 60 à 95% l’émission d’ammoniaque (NH3). Ainsi, la quantité de NH3 dans le sol pour un même volume de lisier épandu va-t-elle considérablement augmenter…et, par conséquent, l’impact sur nos rivières.
Didier Pruneau, 5 mars 2025
Sources :
Étude de l’état de santé des rivières karstiques en relation avec les pressions anthropiques sur leurs bassins versants -François Degiorgi, Pierre-Marie Badot. Laboratoire Chrono-environnement - CNRS - UFC (UMR 6249). 2020, pp.47 https://hal.science/hal-04764319v1
L’état de la Loue : Avis sur les Recherches et les Etudes en cours menées sur la rivière et son bassin versant. Juillet 2015. Conseil Scientifique du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée (Président B. Chastan).
NUTRI-Karst : Charlier J-B, Tourenne D, Hévin G, Desprats J-F. Réponse des agro-hydro-systèmes du Jura face au changement climatique et aux activités anthropiques. Rapport final de la Tâche 1. BRGM/RP-72229-FR, Version 1 du 18 novembre 2022.
Pavic D, Grbin D, Hudina S, Prosenc Zmrzljac U, Miljanovic A, Kosir R, Varga F, Curko J, Marcic Z, Bielen A. Tracing the oomycete pathogen Saprolegnia parasitica in aquaculture and the environment. Scientific Reports. 12, 16646, 2022.
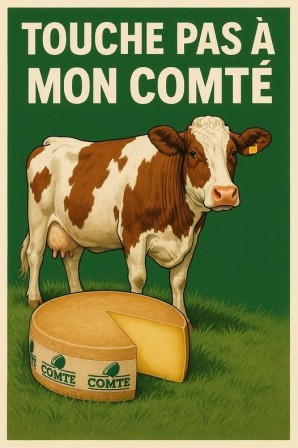
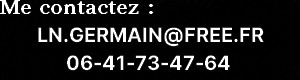











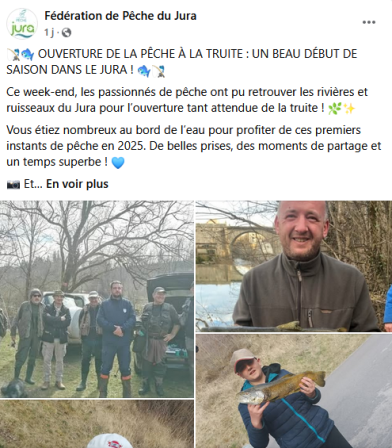











Derniers commentaires